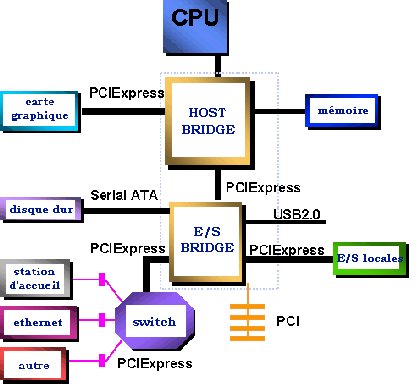©
2000-2015 LHERBAUDIERE
14 pages à l'impression
22 mars 2013
 |
©
2000-2015 LHERBAUDIERE |
dernière
mise à jour 22 mars 2013 |
|
Architecture matérielle d'un PC
La technologie pentium (4/4)
| une
plus grande complexité |
||||
| une
facilité d'emploi |
||||
| indispensable? |
||||
| pour
les accros |
||||
| indispensable |
||||
| pour
les électroniciens |
||||
la
source de bien des maux |
||||
| la
nouvelle norme |
||||
| une collection d'icônes pour visiter tout le site |
||||
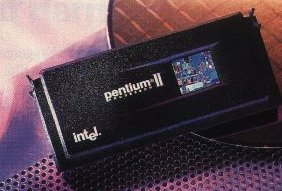
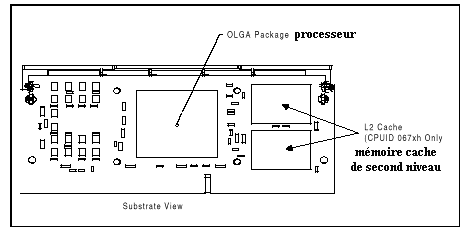


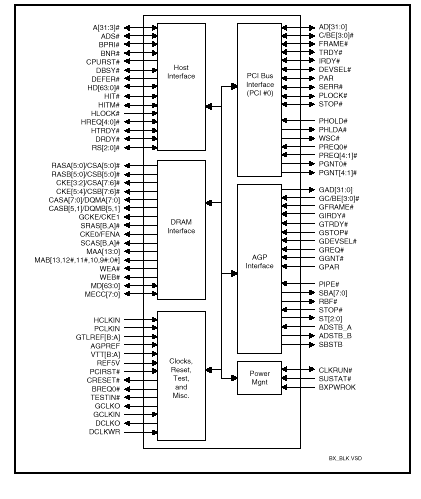
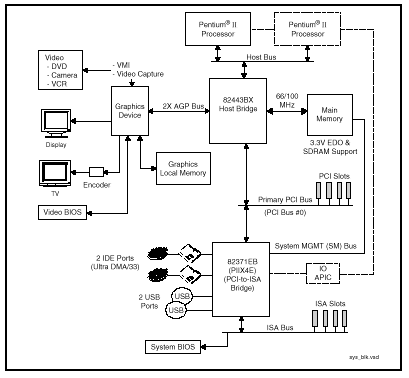

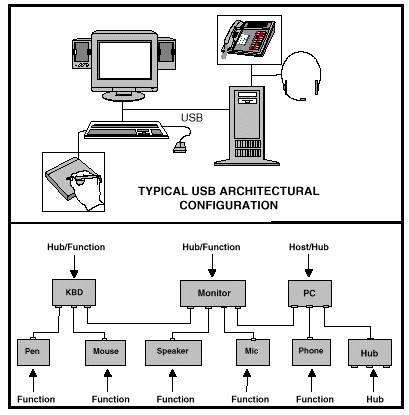

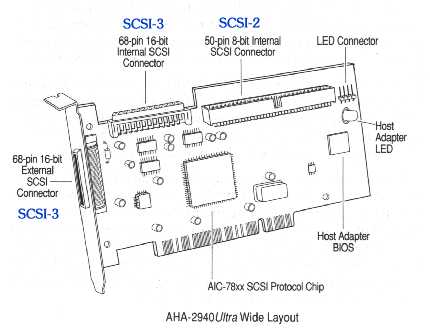
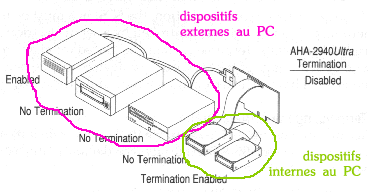
| configuration OS | modèle plug and play du PCI | sans changement |
| couche logicielle | drivers et logiciels PCI | |
| couche transactionnelle | protocole paquets | même topologie que TCP/IP |
| couche liaison de données | intégrité des données | |
| couche physique | série point à point différentiel | couche évolutive |
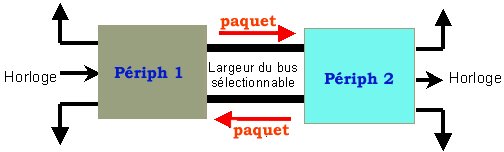
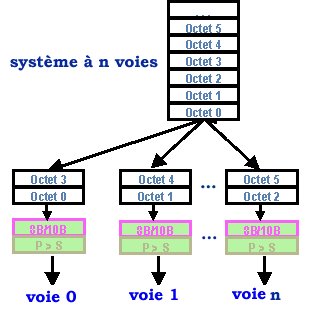
couche
transactionnelle |
en-tête |
données |
||||
couche
de liaison |
Num
de séquence |
paquet
issu de la couche précédente |
CRC |
|||
couche
physique |
trame |
paquet
issu de la couche précédente |
trame |
|||