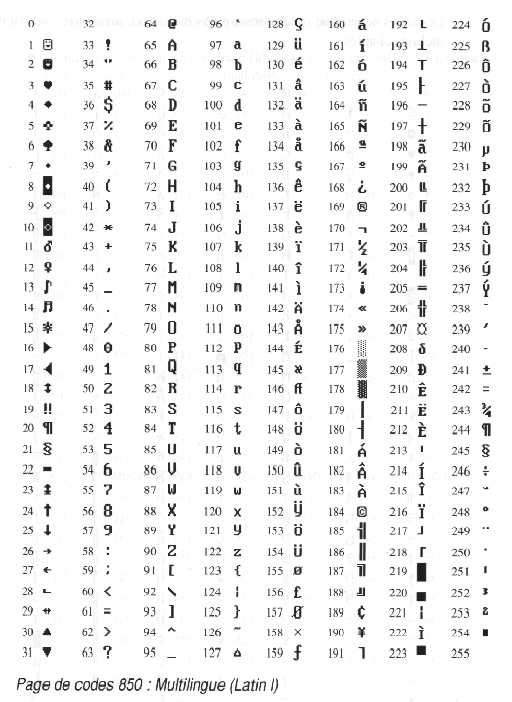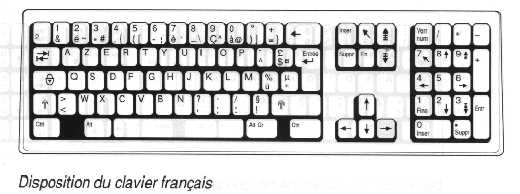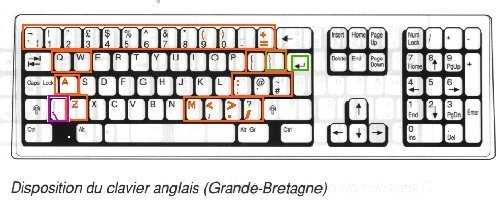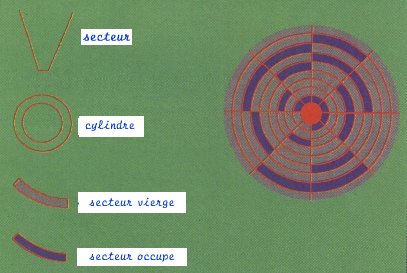©
2000-2015 LHERBAUDIERE
7 pages à l'impression
17 décembre 2012
 |
©
2000-2015 LHERBAUDIERE |
dernière
mise à jour 17 décembre 2012 |
|
|
GLOSSAIRE informatique première
partie (1/3)
|
Sans doute l'avez-vous remarqué, les informaticiens sont des gens bizarres, dont l'une des activités majeures semble être d'inventer chaque matin un nouveau sigle, un nouvel acronyme pour désigner d'une manière compliquée quelque chose de très simple qui aurait pu se contenter d'un vocable issu du Littré. C'est pourquoi nous essayons ici de faire l'opération inverse qui consiste à expliciter dans un vocabulaire accessible à tous ces acronymes étranges. Quand il y a un équivalent français nous l'avons donné, mais nombre de ces termes sont anglo-saxons et non traduits.