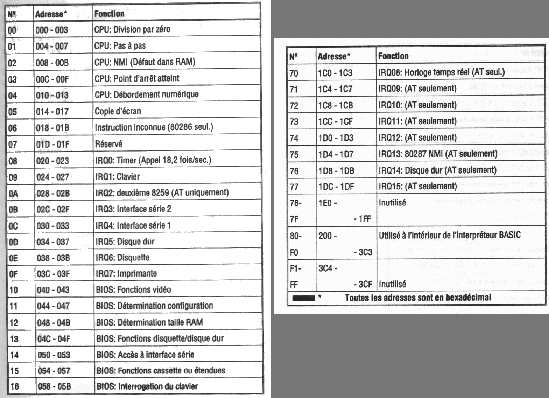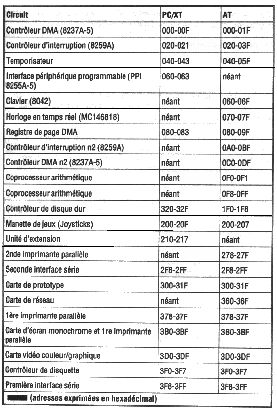©
2000-2015 LHERBAUDIERE
5 pages à l'impression
22 mars 2013
 |
©
2000-2015 LHERBAUDIERE |
dernière
mise à jour 22 mars 2013 |
|
Architecture
matérielle d'un PC
processeur
et organisation mémoire (3/4)
| le processeur | les éléments fondamentaux du processeur | |||
| l'adressage mémoire | la segmentation | |||
| plan mémoire | où se trouve tout | |||
| une collection d'icônes pour visiter tout le site | ||||
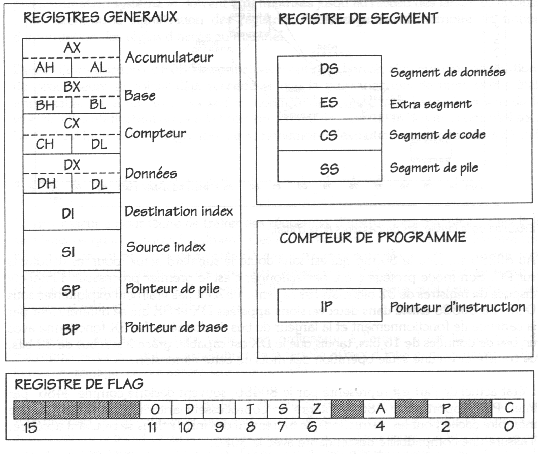
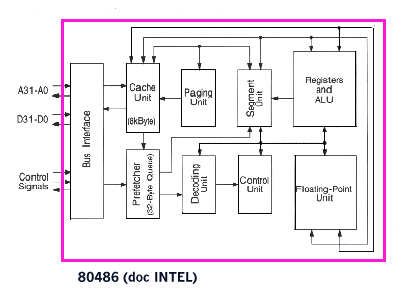
l’adressage mémoireNOTE : Si vous souhaitez comprendre ce qu'est un cycle fetch et mieux vous rendre compte de comment fonctionne effectivement un processeur, lisez, dans le module sur l'électronique, le chapitre introductif aux microprocesseurs.
| 4 gigaoctets | ||
| mémoire étendue XMS | ||
| 1 Mégaoctet | ||
| system Bios | ||
| 896K | ||
| extensions BIOS | éventuellement mémoire EMS | |
| 766K | ||
| RAM vidéo | ||
| 640K | ||
| |
transfert command.com | |
| |
programmes d’application | |
| command.com résident | ||
| device= | ||
| MSDOS.SYS | ||
| IO.SYS | ||
| données DOS, données BIOS, vecteurs d’interruption | ||
| 0K |