
© 2000 - 2015
Lherbaudiere
18 mars 2013
 |
Copyright © 2000 - 2015 Lherbaudiere |
9 pages à l'impression | dernière
mise à jour 18 mars 2013 |
S
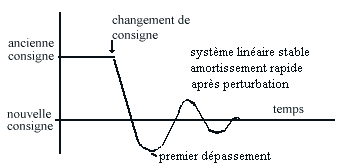
 .
On montre qu'un système linéaire est stable si, en décrivant
le lieu de transfert en boucle ouverte dans le sens des fréquences croissantes,
on laisse le point critique -1+ j0 à sa gauche. Il est instable dans
le cas contraire.
.
On montre qu'un système linéaire est stable si, en décrivant
le lieu de transfert en boucle ouverte dans le sens des fréquences croissantes,
on laisse le point critique -1+ j0 à sa gauche. Il est instable dans
le cas contraire.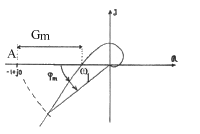


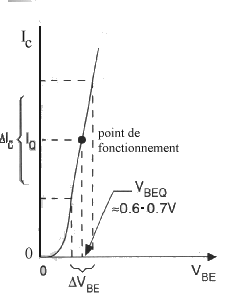
 |