introduction
La force motrice de l’eau est utilisée depuis des siècles
: les moulins à eau moulaient le grain, actionnaient les soufflets de
forge…
Les grands barrages hydrauliques, réalisés dans les années
50, contribuent à l’effort d’autonomie énergétique
de la France, en produisant de l'électricité à partir d'énergie
renouvelable à hauteur d'environ 15% de notre consommation. L’énergie
hydraulique est une des énergies renouvelables les plus difficiles à
développer aujourd’hui en France car tous les sites importants
sont équipés. Par contre l'énergie hydraulique est également
utilisée pour alimenter des sites isolés (une ou deux habitations,
un atelier d’artisan, une grange…) ou produire de l’électricité
à petite échelle dans des microcentrales ( de moins de 100 kW
à 5 MW) qui participent à la production électrique nationale
à hauteur de 1,5 % et pourraient se développer. Enfin il faut
signaler l'exploitation potentielle des marées et courants marins appellée
à fortement se développer.
un peu d'histoire : les moulins
 .....
.....
un moulin au fil de l'eau et un autre avec canal d'amenée
Historiquement, la première machine hydraulique fut la roue à
palettes: cette roue dont le périmètre est garni de palettes et
godets servait à élever l'eau, les palettes plongeant dans la
rivière permettant le mouvement de la roue. On rencontra ensuite divers
types de roues, jusqu'à la réalisation des premiers moulins hydrauliques
tel celui Barbegal ( près d'Arles), érigé au quatrième
siècle par les Romains et qui comportait 8 roues. L'eau était
captée dans l'Arcoule par un aqueduc de 2 m de largeur et 5,6 m de profondeur.
A Barbegal, l'aqueduc est incliné à 30 degrés. Chaque roue
entraînant une paire de meules, on a estimé la production de farine
à 2,8 tonnes par jour, dont la plus grande partie était exportée
vers Rome à partir d'Arles. Ensuite les moulins se sont propagés
dans toute l'Europe. Vers l'an mil on en comptait plus de 4000 en Angleterre,
tandis qu'en France en 1848 il n'y en avait pas moins de 22500 dont les 3/4
étaient des moulins à blé.

une roue à palettes moderne
Mais ce n'est qu'au 19ème siècle que la turbine hydraulique remplace
la roue. Benoit
Fourneyron imagine la première turbine ayant un rendement
important (de près de 80% à comparer aux quelques 20% des roues
des moulins) en 1826. D'autres vont ensuite perfectionner ce dispositif pour
en décliner diverses versions adaptées à tous les types
de débit/dénivellation..
les grands barrages

le barrage de Génissiat (©
CNR)
La plupart des grands barrages hydroélectriques construits en France
autour des années 50 comportent les mêmes éléments.
La prise d'eau est souvent constituée par une dérivation dont
l'entrée est limitée par un seuil et qui dirige le débit
ainsi dérivé vers le canal d'amenée. Le contrôle
du débit s'effectue le plus souvent, soit par un barrage mobile dans
la rivière, soit par une vanne dans le canal d'amenée lequel relie
la prise d'eau à l'entrée de la centrale. Il est habituellement
à ciel ouvert. Une grille protège la turbine contre les corps
charriés par la rivière, tandis que le dégrilleur, sorte
de peigne ou de râteau, débarrasse la grille des éléments
flottants accumulés
La conduite forcée est un tuyau qui relie l'extrémité du
canal d'amenée (au sommet de la pente) à la turbine (au pied de
la pente). Elle supporte à son extrémité inférieure
une pression de service voisine de la hauteur de chute. La turbine transforme
ensuite l'énergie de l'eau en énergie mécanique. Une turbine
moderne comprend des parties fixes, de réglage et une partie mobile (la
roue). Les organes fixes et de réglage ont pour rôle essentiel
de diriger l'eau sur la roue dans les meilleures conditions possibles; la partie
mobile est destinée à produire un couple moteur sur l'arbre en
transformant en puissance mécanique la plus grande fraction possible
de la puissance disponible. Pour produire de l'électricité (courant
alternatif 50Hz) il est indispensable que l'alternateur tourne à vitesse
constante, pour cela un régulateur de vitesse va synchroniser la vitesse
de rotation de la turbine avec l'alternateur. Il a aussi la fonction d'aide
au démarrage et à l'arrêt de la turbine en actionnant le
distributeur.
L'alternateur permet de transformer l'énergie mécanique en électricité.
Il comporte un induit fixe (stator) et un inducteur tournant (rotor). Les alternateurs
peuvent être classifiés suivant l'excitation du rotor (voir module
électronique de puissance de ce site). En ce qui concerne l'alternateur
synchrone, l'excitation est produite par une petite génératrice
annexe qui produit un courant créant un champ magnétique dans
le rotor. Dans le cas de l'alternateur asynchrone, la fréquence et le
voltage du courant sont imposés par le réseau.
Un canal relie la sortie des turbines au lit du cours d'eau aménagé.
La puissance hydroélectrique installée dans le monde en 2004 était
estimée à 715 gigawatts (GW), soit environ 19% de la puissance
électrique mondiale (15 % en Europe). Cependant, la proportion d'énergie
hydroélectrique produite est moindre que la puissance installée
ne pourrait le faire croire, car elle sert principalement à assurer l’équilibre
instantané entre la production et la consommation d’électricité.
En France, par exemple, la puissance installée est de 25 GW, soit 22
% de l’ensemble des centrales contribuant à l’alimentation
des réseaux publics alors que la production ne représente qu'environ
15 %.
les microcentrales
Les microcentrales dérivées des anciens moulins sont l'une des
possibilités non encore saturées de développement d'usage
de l'eau pour produire de l'électricité.
Les centrales au fil de l'eau utilisent une partie du débit des rivières
pour produire de l'énergie électrique. Elles tournent en continu,
car il n'existe pas de bassin d’accumulation pouvant retenir l’eau.
On distingue les centrales au fil de l’eau équipées de turbines
à axe vertical (rivières à pente forte) et celles équipées
de turbines à axe horizontal (rivières à fort débit
et à petite chute). La production d'électricité implique
l'utilisation d'un multiplicateur car la roue tourne en général
lentement (2 tours par minute par exemple) tandis que l'alternateur demande
une vitesse de rotation de 1500 tours/mn
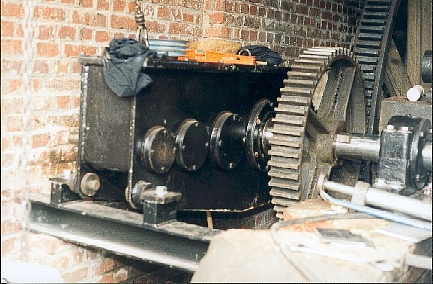
multiplicateur utilisé sur l'un des moulins de
la Durdent (Cany 76)
Malgré des coûts de réalisation généralement
élevés, les coûts de maintenance sont raisonnables, les
installations sont prévues pour durer longtemps, et l'énergie
de l'eau est gratuite et renouvelable si elle est bien gérée .
Donc le bilan est plutôt positif, c'est un des systèmes de production
d'électricité les plus rentables ; en outre c'est un des plus
souples. Dans certaines régions on envisage même des systèmes
réversibles, c'est à dire qui remontent l'eau aux heures creuses
avec leur pompe (la turbine peut effectivement fonctionner en pompe selon son
sens de rotation tandis que l'alternateur peut jouer le rôle de moteur)
alimentée par d'autres sources alors en suurproduction (éolienne
ou centrale nucléaire) et vont fonctionner en génératrice
à plein régime aux heures de pointe ce qui économiquement
se révèle très rentable puisque le prix de vente du courant
n'est pas le même selon les périodes.
Impact environnemental
L'hydroélectricité est
considérée comme une énergie propre et inépuisable,
contrairement au pétrole ou au gaz naturel. Ceci est vrai pour les
microcentrales au fil de l'eau. Par contre il convient d'être plus nuancé
pour les grands barrages, et tout particulièrement ceux situés
dans des pays tropicaux. En effet dans ce dernier cas le barrage retient non
seulement l'eau mais aussi tout ce qu'elle transporte et l'eau stagnante favorise
certains processus biochimiques de dégradation. L'activité bactériologique
dans l'eau des barrages relâche alors d'énormes quantités
de méthane (gaz ayant un effet de serre 20 fois plus puissant que le
CO2). Par ailleurs il faut noter que la plupart des barrages européens
ont entrainé une raréfaction des poissons migrateurs (tels les
saumons ou les anguilles) dans le cours supérieur des rivières,
où ils avaient l'habitude de venir frayer, et même dans le cours
inférieur, où les fluctuations brutales de débit perturbent
leur métabolisme.
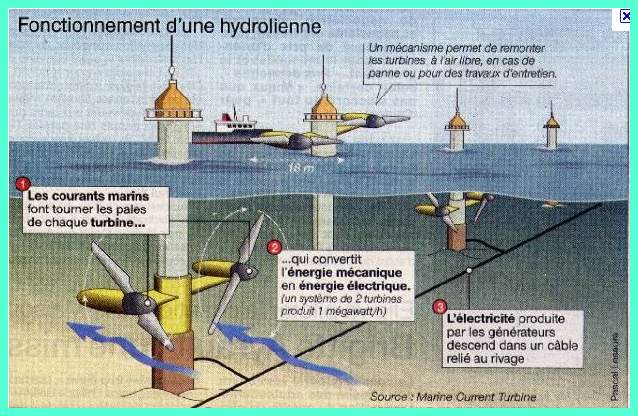 Les
moulins à marée ne datent pas d'aujourd'hui et dès 1925
un projet d'usine marémotrice fut envisagé sur l'estuaire de
la Rance, mais ce n'est qu'au début des années soixante qu'il
fut réalisé en reprenant l'idée basique du barrage. Lors
de la marée montante on accumule l'eau en amont du barrage et à
marée basse cette eau va entrainer un ou plusieurs groupes à
bulbes jusqu'à ce que la réserve accumulée lors de la
marée précédente soit épuisée. La puissance
installée est de 240MW mais la disponibilité de la centrale
n'est que de 25% du temps en fonction de la marée. Notons que la France
était très en avance dans l'idée d'exploiter l'énergie
marine mais que depuis 1966 le lobby nucléaire a réussi à
bloquer tout nouveau développement de cette technique.
Les
moulins à marée ne datent pas d'aujourd'hui et dès 1925
un projet d'usine marémotrice fut envisagé sur l'estuaire de
la Rance, mais ce n'est qu'au début des années soixante qu'il
fut réalisé en reprenant l'idée basique du barrage. Lors
de la marée montante on accumule l'eau en amont du barrage et à
marée basse cette eau va entrainer un ou plusieurs groupes à
bulbes jusqu'à ce que la réserve accumulée lors de la
marée précédente soit épuisée. La puissance
installée est de 240MW mais la disponibilité de la centrale
n'est que de 25% du temps en fonction de la marée. Notons que la France
était très en avance dans l'idée d'exploiter l'énergie
marine mais que depuis 1966 le lobby nucléaire a réussi à
bloquer tout nouveau développement de cette technique.
Aujourd'hui l'idée d'exploiter
l'énergie marine est reprise mais dans un environnement différent
puisqu'il s'agit d'installation à hydroliennes, équivalent des
éoliennes mais immergées en pleine mer, donc sous le niveau
de la mer, et entrainées en permanence via les courants marins. Ce
concept qui va être développé à grande échelle
au nord de l'Ecosse, au voisinage des iles Hébrides dans le chenal
proche d'Islay et Jura où règne un courant constant d'environ
11km/h, présente de très nombreux avantages : permanence du
courant, absence de pollution et d'atteinte à l'environnement, aucune
dangerosité particulière. Le problème de la corrosion
des hélices par l'eau de mer qui a un temps freiné le développement
de cette technologie est parfaitement maitrisé aujourd'hui grâce
à certains aciers spéciaux.
La première centrale devrait être
opérationnelle d'ici 2016, mais le gouvernement écossais envisage
d'atteindre dès 2020 une production d'énergies renouvelables
correspondant à 80% des besoins de l'ensemble de l'Ecosse.




 .....
.....
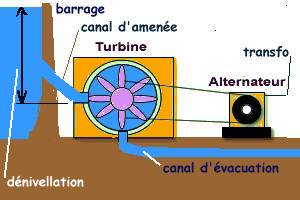
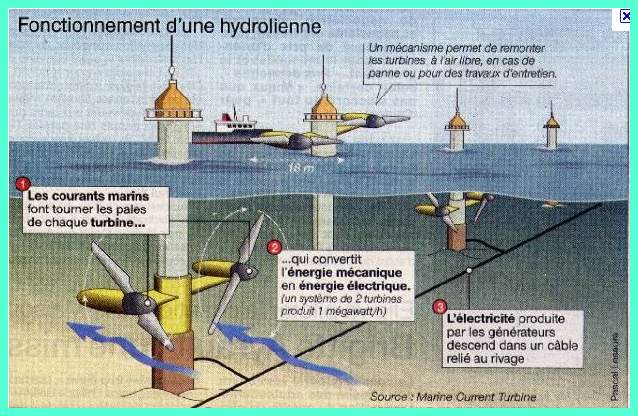 Les
moulins à marée ne datent pas d'aujourd'hui et dès 1925
un projet d'usine marémotrice fut envisagé sur l'estuaire de
la Rance, mais ce n'est qu'au début des années soixante qu'il
fut réalisé en reprenant l'idée basique du barrage. Lors
de la marée montante on accumule l'eau en amont du barrage et à
marée basse cette eau va entrainer un ou plusieurs groupes à
bulbes jusqu'à ce que la réserve accumulée lors de la
marée précédente soit épuisée. La puissance
installée est de 240MW mais la disponibilité de la centrale
n'est que de 25% du temps en fonction de la marée. Notons que la France
était très en avance dans l'idée d'exploiter l'énergie
marine mais que depuis 1966 le lobby nucléaire a réussi à
bloquer tout nouveau développement de cette technique.
Les
moulins à marée ne datent pas d'aujourd'hui et dès 1925
un projet d'usine marémotrice fut envisagé sur l'estuaire de
la Rance, mais ce n'est qu'au début des années soixante qu'il
fut réalisé en reprenant l'idée basique du barrage. Lors
de la marée montante on accumule l'eau en amont du barrage et à
marée basse cette eau va entrainer un ou plusieurs groupes à
bulbes jusqu'à ce que la réserve accumulée lors de la
marée précédente soit épuisée. La puissance
installée est de 240MW mais la disponibilité de la centrale
n'est que de 25% du temps en fonction de la marée. Notons que la France
était très en avance dans l'idée d'exploiter l'énergie
marine mais que depuis 1966 le lobby nucléaire a réussi à
bloquer tout nouveau développement de cette technique.