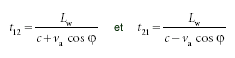deuxième
partie (2/4) : débitmètre volumique/vitesse
| |
le
classique |
| |
pour
les gaz |
| |
le
plus simple |
| |
un
emploi limité |
| |
une
technique aisée |
| |
notre
cher radar! |
 |
 |
 |
 |
une collection d'icônes
pour visiter tout le site |
La principale
mesure de débit consiste en fait en une mesure de vitesse du fluide
dont on déduit le débit volumétrique par un calcul simple
puisqu'il s'exprime par  en fonction de la vitesse et du diamètre de la canalisation.
en fonction de la vitesse et du diamètre de la canalisation.
débitmètre mécanique
à hélice (ou turbine)
Ce principe est l'un
des premiers imaginé. Un dispositif à ailettes ou hélicoidal
est placé dans l'axe de la conduite ou perpendiculairement et l'écoulement
entraine une rotation de ce rotor avec une vitesse liée à celle
du fluide. Il suffit alors de compter le nombre de tours/mn pour avoir la
vitesse et par suite le débit du fluide.
..


Lorsqu'il s'agit d'un liquide on choisira une turbine, lorsqu'il s'agit d'un
gaz ce sera une hélice et le débitmètre sera alors parfois
qualifié d'anémomètre (voir chapitre climatologie). Le
plus souvent le comptage sera réalisé par le biais d'un dispositif
magnétique (un aimant permanent est solidaire du rotor et passe à
proximité d'un "ils" (interrupteur
à lame souple) qui en se fermant va
donc générer une impulsion envoyée à un compteur.
L'autre solution est d'employer un bobinage fixe qui sera perturbé par
le passage de l'aimant générant ici encore une ddp de courte durée
comptabilisable.
Ce système
ne fonctionne bien qu'avec des fluides propres et peu visqueux car il ne faut
pas encrasser les paliers de soutien du rotor sous peine de créer des
frottements importants ralentissant la rotation. La précision peut
être très satisfaisante (jusqu'à 0.2%) mais le comptage
nécessite une certaine durée ce qui réduit les possibilités
de mesure de débit très rapidement variable.
anémomètre à fil chaud
Pour les débits
gazeux on utilise fréquemment un anémomètre à
fil chaud constitué d'un fil résistant parcouru par un courant
constant élevant sa température et placé dans l'écoulement.
L'élément de mesure est chauffé en continu. Il en résulte un échange
de chaleur entre fil et écoulement et la température résultante
est significative de la vitesse de l'écoulement.
Trois versions de
ce principe sont commercialisées, soit on mesure la résistance
du fil chaud alimenté par un courant constant, soit on alimente le
fil à puissance constante et on mesure la température d'un capteur
de température placé à proximité et qui est représentative
de la quantité de chaleur transportée du fil vers le transducteur
par l'écoulement et donc de la vitesse de celui-ci. Soit à l'aide
d'un circuit de régulation, la température de l'élément est main-tenue constante,
ce dernier étant refroidi par l'écoulement de l'air. Le courant de régulation
est alors proportionnel à la vitesse de l'écoulement.
La précision
varie selon la vitesse et la version car la réponse n'est pas toujours
linéaire, l'optimum se situant entre 20 et 120km/h. En dehors de cette
plage les mesures sont très délicates.
débitmètre électromagnétique
Un procédé très élégant
exploite tout simplement la loi de Faraday précisant qu'une fem est
générée par un conducteur se déplaçant
dans un champ magnétique. Dans ce cas on isole électriquement
la canalisation, place deux électrodes dans une direction perpendiculaire
au champ magnétique et c'est le fluide lui-même qui va jouer
le rôle de conducteur. La fem recueillie entre les deux électrodes
est directement proportionnelle à la vitesse, mais ce principe ne fonctionne
que pour des fluides conducteurs ce qui exclut son utilisation dans de nombreux
cas (en particulier avec nombre de produits pétroliers. Par contre
ce principe fonctionne aussi bien avec de petites canalisations de quelques
millimètres de diamètre que de grandes de plusieurs mètres
avec une précision atteignant 1% pour des débits notables. En
cas de faible vitesse d'écoulement le signal recueilli est très
faible (microvolts) et la précision s'en ressent.
Si B est
le champ magnétique, D le diamètre interne de la conduite, V
la tension induite, Q le débit volumique, v la vitesse de l'écoulement
L la distance entre les électrodes de mesure la loi de Faraday nous
indique que V =kBLv, k étant une constante. Or le débit
volumétrique s'exprime par  en remplaçant v par son expression on en tire donc Q=K(V/B) ou K est
une autre constante.
en remplaçant v par son expression on en tire donc Q=K(V/B) ou K est
une autre constante.
En pratique
le champ électromagnétique est obtenu grâce à deux
bobinages placés de part et d'autre de la canalisation et alimentés
en alternatif. Cela permet d'éviter la polarisation des électrodes.
Le signal recueilli est donc de même fréquence et on va l'amplifier
grâce à un amplificateur différentiel avant de le démoduler
classiquement (cf chapitre transmission).
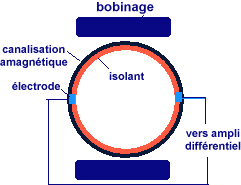
...

L'un des
points fort de cette méthode c'est que le capteur ne perturbe pas l'écoulement
ce qui revient à dire que la viscosité du fluide n'intervient
absolument pas dans le résultat, non plus que la température
qui peut être relativement élevée (quelques centaines
de °C).
anémomètre ionique
Lorsque
le fluide n'est pas conducteur, on s'inspire du procédé précédent
en l'ionisant entre deux électrodes soumises à une ddp suffisante.
Pour en déduire la vitesse et donc le débit on va utiliser trois
électrodes alignées (en fait trois fils perpendiculaires à
l'axe de la canalisation) et polarisées comme sur le schéma.
Il est intuitif que l'écoulement va perturber
les deux courants ioniques I1 et I2 augmentant l'un et diminuant l'autre :
la différence sera donc significative de la vitesse et du sens de l'écoulement.
Pour obtenir un fonctionnement stable on va
choisir une ddp élevée (quelques milliers de volts) dont il
résultera des courants de l'ordre de l'ampère et donc une différence
I2-I1 aisée à mesurer.
débitmètre à ultrasons
On dispose
un émetteur et un récepteur d'ultra-sons le long de la canalisation
et on mesure le temps écoulé entre l'émission d'une impulsion
et sa réception. Ce temps dépend à la fois de la vitesse
du son dans le liquide mais aussi de la vitesse de l'écoulement qui
peut-être turbulent. Il est clair que le fluide doit être propre
car la dispersion des ondes acoustiques provoquées par des particules
solides en mouvement gènerait considérablement la mesure. On
emploie ce procédé plutôt dans des canalisations de grand
diamètre et pour des fluides pour lesquels la méthode précédente
ne convient pas, c'est à dire typiquement pour les hydrocarbures. La
précision est importante et le temps de réponse s'exprime en
millisecondes (mesure de temps).
L'émetteur rayonnant selon une sphère, il n'est pas nécessaire
de positionner l'émetteur et le récepteur en face l'un de l'autre,
c'est à dire de les orienter d'un certain angle  par rapport à la direction de la canalisation. Il en résulte que
ces deux éléments ne débordent quasiment pas à l'intérieur
de celle-ci, ce qui n'entraine aucune perte de charge. En pratique on disposera
d'un système double : on mesurera d'abord le temps de transit comme sur
la figure (dans le sens de l'écoulement) puis on inversera émetteur
et récepteur et mesurera le transit contre l'écoulement et c'est
à partir de la différence de ces deux temps que l'on déterminera
la vitesse de l'écoulement et donc le débit.
par rapport à la direction de la canalisation. Il en résulte que
ces deux éléments ne débordent quasiment pas à l'intérieur
de celle-ci, ce qui n'entraine aucune perte de charge. En pratique on disposera
d'un système double : on mesurera d'abord le temps de transit comme sur
la figure (dans le sens de l'écoulement) puis on inversera émetteur
et récepteur et mesurera le transit contre l'écoulement et c'est
à partir de la différence de ces deux temps que l'on déterminera
la vitesse de l'écoulement et donc le débit.
Lw est
la distance entre les deux transducteurs, c la vitesse du son, va
la vitesse axiale moyenne recherchée.
débitmètre doppler
Ce débitmètre
a été développé spécifiquement pour les
fluides chargés de particules solides ou de bulles gazeuses. On emploie
ici encore des dispositifs ultrasonores, mais ceux-ci sont ici très
voisins (généralement intégrés dans le même
boitier) et l'onde ultrasonore émise par l'un va être réfléchie
par les particules en mouvement en provoquant un glissement de fréquence
directement proportionnel à la vitesse de l'écoulement (selon
le même principe utilisé par certains radars routiers).
Ici encore le procédé est réservé aux grandes
canalisations, cependant sa précision reste médiocre (plutôt
de l'ordre de 5%).




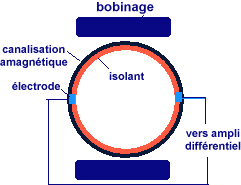 ...
...
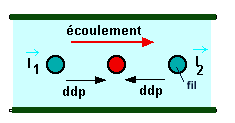
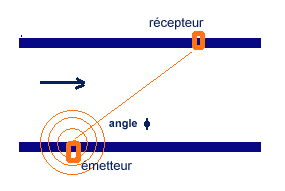
 par rapport à la direction de la canalisation. Il en résulte que
ces deux éléments ne débordent quasiment pas à l'intérieur
de celle-ci, ce qui n'entraine aucune perte de charge. En pratique on disposera
d'un système double : on mesurera d'abord le temps de transit comme sur
la figure (dans le sens de l'écoulement) puis on inversera émetteur
et récepteur et mesurera le transit contre l'écoulement et c'est
à partir de la différence de ces deux temps que l'on déterminera
la vitesse de l'écoulement et donc le débit.
par rapport à la direction de la canalisation. Il en résulte que
ces deux éléments ne débordent quasiment pas à l'intérieur
de celle-ci, ce qui n'entraine aucune perte de charge. En pratique on disposera
d'un système double : on mesurera d'abord le temps de transit comme sur
la figure (dans le sens de l'écoulement) puis on inversera émetteur
et récepteur et mesurera le transit contre l'écoulement et c'est
à partir de la différence de ces deux temps que l'on déterminera
la vitesse de l'écoulement et donc le débit.