
Copyright
© 2000-2015LHERBAUDIERE

26 janvier 2015
 |
Copyright |

|
première
version septembre 2013 |
|
| dernière
mise à jour 26 janvier 2015 |
Introduction
En 2015 il est en principe interdit d'exploiter le prétendu gaz de
schiste en France en raison d'une loi votée par le parlement (dite
loi Jacob), cependant divers pseudos experts financés le plus
souvent (plus ou moins secrètement) par les compagnies pétrolières
et leurs associées souhaitent vivement cette exploitation en vantant
les soit-disant mérites d'une telle exploitation. Il convient donc
de faire le point sur ce dossier.
Aux Etats Unis et aussi au Canada, pays de l'extrême libéralisme et de l'irresponsabilité environnementale, cette exploitation a ravagé (et continue à ravager) des régions entières. Le jeu en vaut-il la chandelle? Qu’est-ce qui est « bon » pour notre avenir ? Ouvrir les vannes pour créer quelques milliers d'emplois, en tapissant la France de dizaines de milliers de puits de forage , dans le but de nous affranchir de notre dépendance au gaz norvégien ou russe ? Ou renoncer au gaz de schiste pour préserver les ressources et les emplois liés au tourisme, à l’agriculture, à la qualité des eaux et plutôt investir dans la transition énergétique ?
Une étude minutieuse menée par Green Cross France nous apprend
ceci :
. 1°, « l’exploitation par fracturation hydraulique n’est
pas rentable sur une période inférieure à quinze ans
(et très incertaine au-delà) si elle paye ses externalités
». Autrement dit, si elle tient compte du coût réel de
ses impacts sanitaires et environnementaux.
2°, le « rendement énergétique de cette technique
est très médiocre ».
3°, « l’occupation de l’espace au sol est largement
supérieure à
celle des dispositifs à énergies renouvelables produisant la
même quantité d’énergie ».
4°, « les risques sanitaires sont très importants ».
5°, les risques environnementaux sont multiples. et « aucune technique
alternative ne permet d’éliminer ces risques ».
le procédé actuel
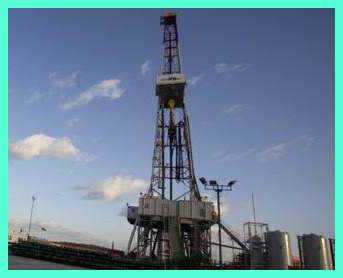 Le gaz de schiste, également appelé
gaz de roche-mère, est un gaz naturel contenu dans des roches marneuses
ou argileuses riches en matières organiques, roches qui peuvent avoir
une structure litée de schiste. Contrairement au gaz naturel conventionnel
qui est retenu dans une roche perméable permettant une exploitation
facile, le gaz de schiste est piégé dans les porosités
d'une roche rendue imperméable par l' argile qu'elle contient.
L'extraction du gaz de schiste, particulièrement difficile, nécessite
le recours systématique aux techniques du forage dirigé et de
la fracturation hydraulique particulièrement couteuses.
Le gaz de schiste, également appelé
gaz de roche-mère, est un gaz naturel contenu dans des roches marneuses
ou argileuses riches en matières organiques, roches qui peuvent avoir
une structure litée de schiste. Contrairement au gaz naturel conventionnel
qui est retenu dans une roche perméable permettant une exploitation
facile, le gaz de schiste est piégé dans les porosités
d'une roche rendue imperméable par l' argile qu'elle contient.
L'extraction du gaz de schiste, particulièrement difficile, nécessite
le recours systématique aux techniques du forage dirigé et de
la fracturation hydraulique particulièrement couteuses.
La « fracturation hydraulique » est la dislocation ciblée de formations géologiques peu perméables par le moyen de l'injection sous très haute pression d'un fluide destiné à fissurer et micro-fissurer la roche. Cette fracturation peut être pratiquée à proximité de la surface, ou à grande profondeur (à plus de 4 km dans le cas du gaz de schiste), et à partir de puits verticaux, inclinés ou partiellement horizontaux.
Quand la pression du fluide, injecté à la profondeur voulue,
dépasse celle de l'eau interstitielle de la roche créée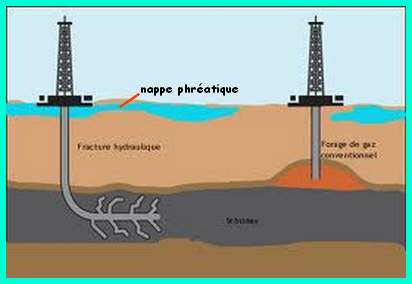 au point d'application par le poids des roches situées au dessus, une
ou des fractures s'initient. Elles vont s'élargir et se propager sur
quelques centaines de mètres grâce à l'injection continue
du fluide. La direction que peuvent prendre les fractures est loin d’être
entièrement contrôlable. Pour éviter que tout ne s'effondre
lorsqu'on récupère le gaz on ajoute dans le fluide des microbilles
de céramique ou du sable censés remplir les fractures tout en
conservant la porosité nécessaire à la circulation du
gaz à extraire. Cependant ce processus est insuffisant et compte tenu
de la complexité du milieu argileux concerné la perturbation
biologique créée par cette injection de fluide risque de provoquer
le développement de bactéries qui gèneraient fortement
l'extraction. On doit donc ajouter à cette eau quelques produits chimiques
antibactériens qui bien évidemment de sont pas du tout anodins.
au point d'application par le poids des roches situées au dessus, une
ou des fractures s'initient. Elles vont s'élargir et se propager sur
quelques centaines de mètres grâce à l'injection continue
du fluide. La direction que peuvent prendre les fractures est loin d’être
entièrement contrôlable. Pour éviter que tout ne s'effondre
lorsqu'on récupère le gaz on ajoute dans le fluide des microbilles
de céramique ou du sable censés remplir les fractures tout en
conservant la porosité nécessaire à la circulation du
gaz à extraire. Cependant ce processus est insuffisant et compte tenu
de la complexité du milieu argileux concerné la perturbation
biologique créée par cette injection de fluide risque de provoquer
le développement de bactéries qui gèneraient fortement
l'extraction. On doit donc ajouter à cette eau quelques produits chimiques
antibactériens qui bien évidemment de sont pas du tout anodins.
Une opération individuelle de fracturation est généralement réalisée en quelques heures -exceptionnellement plusieurs jours-, et de très nombreuses fracturations sont échelonnées le long d'un même forage horizontal unique. Au final, pendant la phase d'extraction, ces zones de fissures artificielles régulièrement espacées vont permettre de drainer des volumes de roches relativement peu éloignées de l'axe du puits, l'imperméabilité de la roche reprenant rapidement le dessus. De ce fait, la productivité d'un puits fracturé chute assez rapidement avec le temps : ainsi aux Etats Unis on constate dès la première année, une chute de productivité atteignant plus de 90% au bout de cinq ans. Ce qui oblige à effectuer un nouveau forage à quelques centaines de mètres du précédent.
Les problèmes
Comme précisés dans l'introduction ils sont de nature environnementale
et économiques. En premier lieu il y a les incertitudes géologiques
poouvant conduire à faire des forages là où il n'y a
presque rien à récupérer. Mais le plus important ce sont
les conséquences environnementales directes ou indirectes.
1° lors du forage des bulles de gaz sont rejetées dans l'atmosphère pendant
un certain nombre de jours avant que ce forage ne soit considéré
comme rentable et raccordé à un pipeline. Et se poursuivent dès lors
que le puits est abandonné en raison de sa chute de productivité.
On a constaté en Amérique du Nord que parfois plus de 8% du
gaz était ainsi perdu. Ces fuites massives de méthane
participent à l'aggravation de l'effet de serre.
2° On constate aux USA une forte dégradation des paysages en raison
de la multiplication des forages, auxquels il faut ajouter les stockages,
les routes d'accès...
3° les dégradations environnementales des écosystèmes locaux, des nappes
souterraines et de surface, du sol et du sous-sol sont évidentes. En
particulier il est évident qu'au cours du forage il est probable que
l'on transperce une voire plusieurs nappes phréatiques avec le risque
de pollution irrémédiable de celles-ci.
4° Les impacts à moyen et long terme de la fracturation profonde
ne semblent pas avoir fait l'objet d'études sérieuses ni des
scientifiques ni surtout des administrations théoriquement concernées..
5° Dans un pays comme la France dont le tourisme est actuellement une
ressource économique primordiale (la seule qui ne soit pas en décroissance)
on peut se poser la question de l'intérèt à long terme
d'une dégradation irréversible de certaines zones touristiques
pour une exploitation qui ne durerait guère plus de quelques années.
6° Enfin cette technique consomme de gigantesques quantités d'eau,
quantités qui seraient bien utiles à la consommation humaine.
En outre celà va contribuer à augmenter le coût de l'eau
pour la consommation humaine (car la rareté se traduit toujours par
des prix élevés).
7° Il existe aussi des risques d'explosion, d'incendies, de fuites ou
de surgissement en geyser de fluide. Ils peuvent provenir d'erreurs humaines
ou de déficiences matérielles.
Conclusion : « Le plus sage est probablement de laisser les gaz de schiste dans le sol à ce stade… Ils seront toujours disponibles si quelque jour une technique “propre” venait à être trouvée. »
bibliographie:
Phillips, William John ; Hydraulic fracturing and mineralization
; Journal of the Geological Society (Geological Society of London) ; Août
1972; v. 128; no. 4; p. 337-359;
Howard, G.C. and C.R. Fast (editors), Hydraulic Fracturing, Monograph
Vol. 2 of the Henry L. Doherty Series, Society of Petroleum Engineers New
York, 1970.
Montgomery, Carl T., « Hydraulic Fracturing: History of an Enduring Technology », Journal of Petroleum Technology, Society of Petroleum Engineers, vol. 62, no 12, décembre 2010, p. 26-32
Gaz de schiste : la bataille de France a commencé, Terra Eco N° 51 - octobre 2013
![]() additif
2014 toujours valable en 2015 : faites lire cette page à
votre député et à vos élus locaux.
additif
2014 toujours valable en 2015 : faites lire cette page à
votre député et à vos élus locaux.