
Copyright
© 2000-2015
LHERBAUDIERE
5 pages à l'impression
22 mars 2013
 |
Copyright |
5 pages à l'impression |
version
initiale 2002 |
||
| dernière
mise à jour 22 mars 2013 |
deuxième partie (2/5) : hygromètres à point de rosée et à impédance variable
|
un
procédé optique |
||||
|
peu
employé |
||||
|
le
plus utilisé industriellement |
||||
|
la
désaturation ! |
||||
| une collection d'icônes pour visiter tout le site | ||||
hygromètre
à point de rosée
Pour mesurer l’humidité relative on peut aussi en pratique procéder à la mesure de la température de rosée avec un hygromètre dit à point de rosée dont le schéma de principe est figuré ci-dessous. Il s’agit en fait de prélever un échantillon de l’air à mesurer et de l’amener au contact d’un miroir que l’on refroidit et dont on mesure la température. Lorsque celle-ci atteint le point de rosée l’eau se condense et le faisceau lumineux n’est plus réfléchi par le miroir, la mesure de la température à l’instant d’interruption du faisceau permet de connaître la température de rosée et par suite l’humidité relative de l’air.

En pratique un tel dispositif possède un temps de réponse élevé car le capteur de température (résistance de platine) se trouve en situation intermédiaire entre le bloc thermoélectrique et le miroir ce qui revient à dire qu’en phase de refroidissement sa température est inférieure à celle de la surface du miroir, et qu’inversement en phase de réchauffement (par inversion du générateur thermoélectrique) elle est supérieure. L’obtention d’un résultat précis implique donc un processus alternatif et itératif de chauffage-refroidissement jusqu’à obtention d’une valeur limite ce qui peut prendre de nombreuses minutes.
![]() Notons toutefois que les progrès récents des nanotechnologies
ont induit une miniaturisation de ce dispositif (ex : au Centre de microtechniques
de Neuchatel), réduit à un cube d'environ un inch de côté
et de constante de temps ramenée à l'échelle de la minute.
Notons toutefois que les progrès récents des nanotechnologies
ont induit une miniaturisation de ce dispositif (ex : au Centre de microtechniques
de Neuchatel), réduit à un cube d'environ un inch de côté
et de constante de temps ramenée à l'échelle de la minute.
Les hygromètres à variation d'impédance sont des capteurs dont l'élément sensible possède des propriétés hygroscopiques, c'est à dire, dont la teneur en eau varie en fonction du taux d'humidité de l'air avec lequel il est en équilibre.
Il existe principalement deux types de capteurs à variation d'impédance: les hygromètres résistifs et les hygromètres capacitifs.
Sur un support de faible dimension, on dépose une quantité de substance hygroscopique suivant un motif constituant une résistance. Celle-ci dépendra donc à la fois de la teneur en eau et de la température.
Ex: le capteur type H104C de Toshiba
 à 30%RH
à 30%RH à 90%RH
à 90%RHSi cette solution donne théoriquement des temps de réponse courts, la courbe de réponse d'un tel capteur montre un hystérésis important et une nette tendance à dériver en température.
Le domaine de mesure pour ce type de capteur s'étend généralement de 5% à 95% d'humidité pour des températures comprises entre -10°C et 50°C. Le temps de réponse est théoriquement de l'ordre de 10s pour une précision de 5% environ.
Les hygromètres capacitifs
Le principe de ce type de capteur est basé sur la variation de la capacité
d'un condensateur par l'intermédiaire de sa constante diélectrique.
Le diélectrique, d'une épaisseur de quelques microns, absorbe
les molécules d'eau de l'air ambiant jusqu'à l'équilibre.
Sa capacité est alors donnée par la formule:
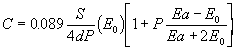
En général, pour ce genre de capteurs, le diélectrique utilisé est soit l'oxyde d'aluminium, soit un polymère. Aux dires des constructeurs, les performances de ces capteurs sont très correctes de 5% à 99% d'humidité et sur une très large gamme de température (de -40°C à +80°C). Le temps de réponse est de 2 à 3 secondes pour une précision de l'ordre de 3%. La principale difficulté liée à ce concept est qu’il implique à la fois une faible épaisseur de diélectrique (pour obtenir une valeur importante de C) et une grande facilité d’accès au coeur du diélectrique (pour obtenir à la fois sensibilité et faible temps de réponse) ce qui est contradictoire. La solution consiste à imaginer un procédé de fabrication conduisant à l’obtention d’une armature poreuse, soit sous forme d’une couche métallique très mince de quelques nanomètres d'épaisseur, généralement de l'or qui est chimiquement très peu réactif mais fragile à l'abrasion, soit, comme dans l’exemple ci-dessous, sous forme d’une électrode métallique épaisse (quelques micromètres) mais craquelée.

La figure ci-dessus représente un capteur capacitif développé au LETI (Grenoble) et commercialisé par la compagnie CORECI à Lyon. Il s’agit d’un principe à base d’électrode active en chrome et de polymère craquelés ce qui lui confère une très grande surface d’échange et donc une bonne sensibilité ainsi qu’une certaine immunité à la pollution.
Le principal
intérêt des hygromètres à variation d'impédance,
qu'ils soient résistifs ou capacitifs, réside dans le fait que
leur mise en oeuvre peut se faire à partir d'une électronique
simple (pont de Wheastone ou oscillateur). Mais ils possèdent cependant
quelques inconvénients:
Il est souvent difficile d'obtenir des caractéristiques parfaitement reproductibles. Si l'on veut avoir une bonne précision, il est nécessaire d'étalonner individuellement chaque capteur. Les caractéristiques du matériau hygroscopique évoluent avec le temps. leur utilisation en milieu pollué provoque rapidement un encrassement du capteur, impliquant non seulement une augmentation du temps de réponse mais aussi parfois des mesures totalement erronées. Enfin, s'il est relativement facile de passer d'un taux d'humidité faible à un taux élevé, l'inverse n'est pas toujours vrai. Le capteur doit en effet évacuer l'excédent d'humidité qu'il a emmagasiné. Selon les cas, le "temps de purge" peut varier de quelques minutes à quelques heures!!!
difficulté d'emploi : la condensation
Comme nous l'avons vu dans cette présentation, le comportement des capteurs est très influencé par le milieu extérieur. Les problèmes liés aux phénomènes de condensation, d'absorption, de pollution, de vieillissement, de sensibilité à la température, d'inertie ne sont pas résolus de manière satisfaisante.
En particulier, aucun capteur commercialisé n'est à l'heure actuelle capable de fonctionner avec un temps de réponse acceptable après passage en atmosphère saturée d'humidité., tout particulièrement si la durée de saturation est importante. On constate en effet des « temps de purge » prohibitifs ainsi que nous allons le montrer dans l’exemple expérimental ci-après, vérifié à plusieurs reprises lors d'études climatologiques de longue durée dans la grande banlieue rouennaise et à proximité de l’abbaye de Saint-Wandrille.
La figure ci-dessous permet de comprendre le problème principal rencontré avec les capteurs de type capacitif du commerce. L’expérience réalisée en extérieur, en Haute Normandie, en juin 1987, est la suivante:
On dispose deux capteurs identiques en milieu extérieur. En fin de journée, l’un est maintenu en extérieur, tandis que l’autre est rentré à l'intérieur d'un local fermé (bureau du chercheur). Pendant la nuit, le capteur en milieu intérieur indique normalement 60 % d’humidité relative ce qui est la valeur effective dans le local considéré. Le capteur extérieur quant à lui voit une humidité relative beaucoup plus importante (en raison de la chute de température nocturne) et son point de fonctionnement se déplace au cours de la nuit du point d jusqu’en b (apparition de rosée) puis jusqu’en a. Le lendemain matin, vers huit heures, le capteur maintenu en intérieur est à nouveau placé en extérieur et, au bout de quelques minutes, il indique une humidité relative de 100% correspondant au point représentatif a sur le diagramme de Mollier, comme le capteur maintenu toute la nuit en extérieur.
Fig. Comportement comparé de deux capteurs
La deuxième phase de l’opération est instructive. En effet, lors de la remontée de température matinale, on constate un comportement divergent des deux capteurs:
le capteur, maintenu nuitamment en intérieur, suit une évolution que l’on peut qualifier de parfaitement normale et son point représentatif, en fonction du temps, se déplace de a vers d (en bleu sur la figure) montrant que l’humidité relative diminue tandis que la re-évaporation de la rosée traduit une légère augmentation de l’humidité absolue de l’air pour retrouver sensiblement la valeur de la veille. Le capteur qui a passé une nuit complète en extérieur, voit son point représentatif suivre une trajectoire différente et tout à fait aberrante. Dans un premier temps, il indique une humidité à saturation (point a jusqu’à b) qui pourrait sembler normale si l’on n’avait pas à notre disposition l’indication différente de l’autre capteur, puis suit la trajectoire de b vers c qui traduit en apparence une augmentation de l’humidité absolue au delà de la valeur de la veille. Cela est surprenant car les conditions climatologiques régnant ce jour là (et que l’on a retrouvées lors d’une expérimentation ultérieure en octobre) indiquaient qu’aucun des paramètres climatologiques n’avait évolué depuis la veille, et en particulier il n’y avait pas de vent et le ciel était complètement dégagé. En un mot il n’y avait dans l’environnement du capteur aucune source nouvelle d’humidité et l’humidité absolue une fois la rosée revaporisée ne peut donc continuer à augmenter. Le processus s’est pourtant poursuivi en apparence jusqu’à 11 heures, puis en environ deux minutes l’indication du capteur est passée du point c au point d laissant supposer que brutalement, à température légèrement croissante (mais quasi constante) l’humidité absolue en excès aurait été miraculeusement résorbée. Ce qui est évidemment physiquement inconcevable.
L’explication rationnelle est la suivante: pendant la nuit, la condensation a été importante et le capteur est en fait "noyé" et il a fallu plus de trois heures pour revaporiser la totalité de l’eau condensée (et en partie physiquement adsorbée sur et dans le diélectrique) et pendant tout ce laps de temps le capteur avait donc une indication sans rapport avec la réalité, la dernière phase de ce comportement aberrant correspondant au désorbage de l’eau dans le diélectrique et donc à cette apparente décroissance rapide de l’humidité de l’air (point c à d).
En pratique, si l’on n’avait pas disposé d’un second capteur dans cette expérimentation, dont on soit certain de la qualité de l’indication, et si les autres paramètres climatologiques n’avaient pas été connus, et particuliers ce jour là, il aurait été impossible de détecter ce comportement aberrant. Et l’on voit bien la conclusion qu’il faut en déduire, c’est que l’on ne peut faire confiance à un capteur d’humidité, opérant en milieu extérieur, dès lors qu’il y a eu une phase nocturne de condensation importante (ce qui est fréquent).
Dans la partie suivante, nous allons donc définir la solution, basée sur le concept de capteur intelligent, envisagée pour résoudre une partie de ces problèmes et ainsi donner le principe d'un nouveau capteur et de son électronique.