
Copyright
© 2000-2015
LHERBAUDIERE
6 pages à l'impression

18 mars 2013
 |
Copyright |
6 pages à l'impression |
 |
version initiale 2003 | |
| dernière
mise à jour 18 mars 2013 |
| pompes volumétriques: palettes | la primaire classique | |||
| compresseur roots | pour les gros débits | |||
| pompe à entrainement : jet de vapeur | vide secondaire | |||
| pompe turbomoléculaire | vide poussé propre | |||
| une collection d'icônes pour visiter tout le site | ||||
pompe à palettes
 A
la fin du XIXe siècle, et au commencement du XXe, on a adapté
à la Technique du Vide les principes de diverses pompes à mouvement
rotatif. Les pompes à palettes, dont la construction est simple et bon
marché, le fonctionnement sûr et la vie longue, sont de beaucoup
les plus répandues : nous nous bornerons essentiellement à leur
étude.
A
la fin du XIXe siècle, et au commencement du XXe, on a adapté
à la Technique du Vide les principes de diverses pompes à mouvement
rotatif. Les pompes à palettes, dont la construction est simple et bon
marché, le fonctionnement sûr et la vie longue, sont de beaucoup
les plus répandues : nous nous bornerons essentiellement à leur
étude.Espace 1: en communication avec le récipient à vider; Espace 2: isolé; Espace 3: en communication avec le conduit de refoulement.
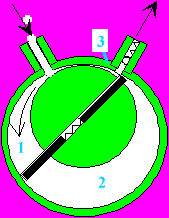 (a)
. . (b)
(a)
. . (b)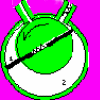
pompes de type ROOTS
 Les
pompes à palettes ne satisfont pas toutes les applications potentielles,
en particulier dans le domaine de la grande industrie chimique, où les
volumes à pomper sont parfois très importants, mais où
les pressions souhaitées sont relativement médiocres. En outre
le dispositif à palettes se prête mal à l'évacuation
de gaz explosifs ou facilement inflammables en raison du risque d'étincelle
du au frottement de la palette sur le stator. Dans ce cas on utilisera le dispositif
ROOTS.
Les
pompes à palettes ne satisfont pas toutes les applications potentielles,
en particulier dans le domaine de la grande industrie chimique, où les
volumes à pomper sont parfois très importants, mais où
les pressions souhaitées sont relativement médiocres. En outre
le dispositif à palettes se prête mal à l'évacuation
de gaz explosifs ou facilement inflammables en raison du risque d'étincelle
du au frottement de la palette sur le stator. Dans ce cas on utilisera le dispositif
ROOTS. 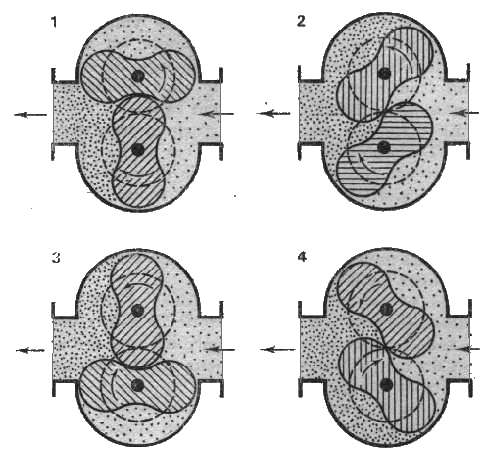
Pompe à jet de vapeur
 On
dit aussi pompes à flux de vapeur et plus généralement
dans le langage des techniciens du vide pompes à
diffusion bien que cette appellation n’ait aucun rapport avec leur
mode de fonctionnement.
On
dit aussi pompes à flux de vapeur et plus généralement
dans le langage des techniciens du vide pompes à
diffusion bien que cette appellation n’ait aucun rapport avec leur
mode de fonctionnement.
pompes turbomoléculaires
 Les
pompes statiques nécessitent un fluide porteur et donc sont susceptibles
de rétrodiffusion d'huile, c'est pourquoi un autre dispositif a été
développé pour les applications où l'on a besoin d'un vide
propre, la pompe turbomoléculaire, dont le principe a été
découvert par Gaède dès 1913.
Les
pompes statiques nécessitent un fluide porteur et donc sont susceptibles
de rétrodiffusion d'huile, c'est pourquoi un autre dispositif a été
développé pour les applications où l'on a besoin d'un vide
propre, la pompe turbomoléculaire, dont le principe a été
découvert par Gaède dès 1913.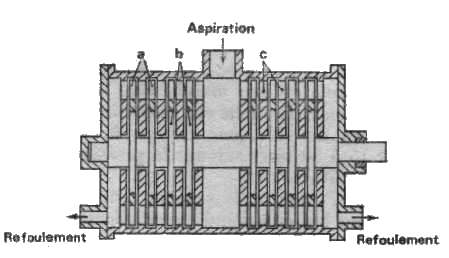
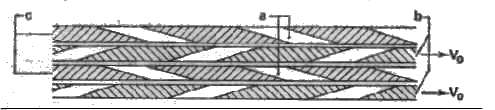
 |
 |